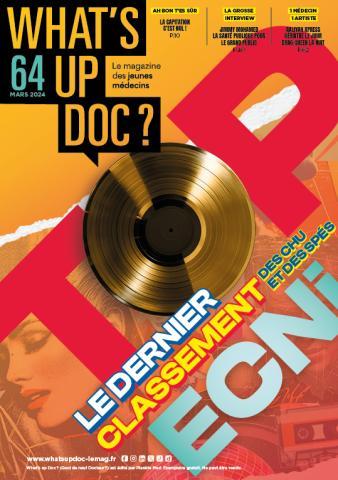« Les médecins généralistes d’aujourd’hui sont incommensurablement meilleurs qu’à l’époque », avance sans scrupules Vincent Renard, 63 ans, généraliste et enseignant. « Quand je me suis installé en 1990, je peux vous dire que mon niveau n’était pas bon. On faisait du mieux que l’on pouvait, mais on était très mauvais ! » Ce fervent défenseur de la spécialité « médecine générale » est aujourd’hui professeur à Paris-Est Créteil et membre du Collège national des généralistes enseignants (CNGE), engagé depuis toujours dans le développement de la formation de cette pratique. À compter de 1984, les futurs généralistes bénéficiaient de 4 semestres de stage en milieu hospitalier : le résidanat. « Sous prétexte de transfert d’expérience, on était surtout de la main-d’œuvre disponible dans les services hospitaliers, à faire des lavements barytés en radiologie... » Avec peu d’importance accordée à la formation des futurs généralistes, et peu de considération aussi.
Pourquoi médecine générale ? « Je n’étais pas issu d’un milieu de médecins et j’avais choisi ces études pour soigner les patients dans leur intégralité. Bachoter et tenter de me classer pour obtenir une place en médecine interne dans le but de finir en spécialité ne m’intéressait pas. Or ce n’était pas le cas de la majorité des étudiants : personne ne voulait être médecin généraliste à cette époque-là. » Le choix se faisait par défaut, en ratant l’internat, avec la pression de l’entourage, ou de celle des médecins des services hospitaliers. « On essayait de décourager les plus motivés. »
Recalée mais pas frustré
Yoko Kikuchi-Maurice a 59 ans et un parcours différent. Elle fait partie de ces recalés de l’internat, mais sans en être frustée. Chacun son parcours de vie. En 6e année, en 1989, elle avait réussi à s’organiser pour faire un stage en médecine interne dans son pays d’origine (sans surprise) : le Japon. Autant dire qu’elle était loin des conférences ou des prépas qui lui auraient permis de se préparer correctement à passer l’internat. Elle convoitait bien une ou deux spécialités, pédiatrie ou gynécologie… Alors à son retour en France, elle tente quand même les concours, sans grande conviction. Ayant échoué, elle démarre son résidanat dans la foulée. Elle enchaîne un semestre en médecine interne « dans les années sida », un autre en pédiatrie, pour finalement ne pas retenter les concours l’année suivante. Bien décidée à devenir généraliste, elle poursuit consciencieusement ses derniers stages hospitaliers : dermatologie, gynécologie… Ensuite, pas d’examen de sortie. Juste la possibilité de visser sa plaque et de recevoir des patients en consultation en ville, sans jamais avoir fait aucun stage auprès d’un praticien, « ou peut-être si, une dizaine de jours » se rappelle-t-elle. « À l’époque, on nous lâchait sans filet ! » Un peu de PMI pour commencer et des vacations aux urgences pédiatriques, puis l’achat d’une patientèle et un cabinet axé à 80 % pédiatrie.
Choisir de ne pas passer l’internat
De son côté, Bernard Dufour, généraliste, 64 ans, ostéopathe et passionné de rugby, ne regrette pas son choix. « Je n’ai pas passé l’internat ; il fallait travailler comme un âne et je jouais au rugby. Venant d’une famille sans médecin, qui avait déjà trouvé extraordinaire que je le devienne, je n’ai pas eu de pression pour faire une spécialité. » Après un stage en orthopédie en 6e année, il démarre son résidanat en réanimation au CHU de Nîmes, qu’il enchaîne par un poste de faisant fonction d’interne (FFI) pendant 5 ans. S’ensuit une installation ex nihilo à Montpellier en 1991, complétée par une activité de médecine manuelle-ostéopathie depuis 1993. « En médecine générale, il faut être compétent sur tout. Alors pour nous c’était compliqué au démarrage, d’autant que l’on apprenait sur le tas. Quelques remplacements, rien de plus ! Mon expérience en réanimation m’avait donné quelques notions de cardiologie, rhumatologie, dermatologie. Il suffisait de s’y mettre : examiner, mais surtout écouter : c’est 90 % du métier ! » Très impliqué dans la traumatologie du sport et président de la commission médicale de la Ligue nationale de rugby pendant 10 ans, il est assez content d’avoir accompagné l’entrée du système de détection des commotions cérébrales durant les matchs, un concept développé par Vogo, une entreprise technologique locale devenue internationale.
https://www.calameo.com/whatsupdoc-lemag/read/005846154223bb7a7cc61?page=1
Avec Vincent Renard, il fait partie de ces quelques promotions de généralistes qui – entre 1985 et 1988 – ont pu inscrire « interne en médecine générale » sur leur plaque. Une appellation rapidement supprimée à la demande des internes de spécialités et des syndicats. « Il ne fallait pas mélanger les bons internes et les "Canada Dry" de la médecine », ironise Vincent Renard. « Un bon témoin du mépris ambiant ! » Est-ce que cela a changé ensuite ? « En 2004, le choix des spécialités se faisait en amphi et ceux qui prenaient médecine générale se faisaient siffler !… »